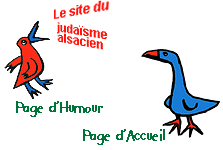L'entraide était la vertu cardinale dans cette communauté misérable
: "Unserem liewe Harjett la'ht 's Herts, waen a Dalphen émen
andre Dalphen Tsdoke gébt", le "bon Dieu a le cœur en joie
quand un pauvre fait l'aumône à un autre pauvre". La pauvreté
ronge et détruit ceux qui en sont les victimes, parce que la trop grande
misère est insupportable. "Dalles on Saltswasser fressé
om sich", "la pauvreté et l'eau salée rongent
ce qui se trouve autour d'elles". Au 18ème et au 19ème
siècles, la misère était grande dans la communauté
juive d'Alsace, dont beaucoup de membres étaient des Lutfmenschen
vivant de petits métiers et d'expédients. Durant la crise et
la famine de 1817, les enfants juifs cueillirent des fleurs sauvages pour
faire de la soupe. Au 18ème siècle, Joseph Lehmann, instituteur
juif à Ribeauvillé,
écrit dans ses Mémoires en judéo-alsacien qu'
"au milieu d'un hiver aussi long et aussi rigoureux
que celui de cette année, où notre approvisionnement ordinaire
de bois ne nous suffit pas, un grand nombre des enfants pauvres qui fréquentent
l'école ont besoin de vêtements et de chaussures" (1).
Dans de nombreuses communes, les Juifs n'étaient pas autorisés
à ramasser du bois mort dans la forêt communale. Et lorsqu'en
avril 1827, le Préfet du Haut-Rhin autorisa les Juifs de Zillisheim
à s'approvisionner dans la forêt appartenant au village, les
paysans renversèrent les tombes du cimetière juif, brisèrent
les portes et les fenêtres de la synagogue et des demeures juives, et
molestèrent leurs habitants. Dans sa jeunesse, le grand
rabbin Salomon Ulmann, fils d'un modeste rabbin de Saverne,
vivait dans un tel dénuement que, ne pouvant acquérir une grammaire
hébraïque, il en emprunta une à un condisciple et consacra
toutes ses soirées, durant une année entière, à
recopier les six cents pages du volume.
[...]
Elias Seibel, le héros de Couronne d'Alexandre Weill, est le fils d'un fripier qui, après avoir "tiré le diable par la queue" et fait faillite, a pris "le bâton de rouleur" ; il était entré dans la corporation des mendiants juifs qui "vont de village en village, s'invitant eux-mêmes à la table de leurs riches coreligionnaires, lançant des injures et des malédictions à ceux qui leur refusent la charité, et occupant les moments perdus à faire des mariages entre les familles israélites répandues en Alsace, en Lorraine, aux bords du Rhin et jusqu'au Palatinat. Le fils vint au monde dans une auberge des pauvres, sur une litière commune, et son père, pour lui donner quelque chose, lui donna le nom d'Elias. Comme Rachel la tragédienne, le jeune Elias voyageait sur le dos de sa mère, enveloppé dans un grand drap sale, et plus d'une fois, pour téter, l'enfant était forcé de grimper comme un singe sur l'épaule de sa mère, qui, la chose faite, le rejetait dans sa sangle de drap, véritable hamac portatif inventé par les bohémiens, très nombreux en Alsace" (2). Plus tard, Madame Riche, ayant découvert l'amour que sa fille Couronne porta à Elias, lui adresse la lettre suivante, qui traduit et son indignation et ses préjugés de classe : "Monsieur, vous ne m'avez jamais trompée un instant. Mauvais sang ne peut mentir, et un proverbe alsacien dit : " la pomme ne tombe pas loin du pommier ". Monsieur, savez-vous qui vous êtes ? J'en doute ; car le fils de Jacob Seibel, s'il se fût connu, n'eût jamais osé demander la fille de madame David Riche. Monsieur, j'ai vu votre mère qui vous portait sur son pauvre dos, enveloppé dans un grand drap sale et troué. Vous lui tendiez la main par dessus l'épaule, et votre mère me tendait la main pour me demander un liard. Votre père, monsieur, s'appelait Jacob le farceur, Jacob le fripier, Jacob le rouleur, Jacob le..." (3).
Les mendiants, qui ont leur tournée attitrée, reçoivent du bedeau un Blett (un billet) leur indiquant l'hôte qui se doit de les accueillir à sa table le vendredi soir et le Shabath à midi. Ils dorment dans une grange, sur la paille, ou parfois dans une chambre du restaurant juif que la communauté met à leur disposition. Certaines communautés possèdent un asile de nuit, Schlaufstätt, aménagé très sommairement, au mobilier des plus rudimentaires. La Schlaufstätt de Seppois est une salle vaste dans une maison appartenant à. la communauté, et habitée par le bedeau, qui, en sa qualité de logeur des pauvres porte le titre significatif de Einleguerre (responsable du cantonnement).
Lors des mariages, quand le père de la mariée distribue aux pauvres le dixième de la dot de sa fille, les mendiants affluent de toute part ; ils sont également présents aux enterrements, et, se pressent à la porte des cimetières, en automne, quand les Juifs se rendent sur les tombes de leurs parents. On prétend, avec un humour un peu lourd que leur devise est : "Vom neemme word mer net arm", "A accepter, on ne s'appauvrit pas".
L'une des figures prestigieuses parmi les schnorrer, connue jusqu'aux extrémités les plus reculées de l'Alsace, était Mauchele-Zellwiller. Moïse Baer, né en 1815 à Zellwiller, était un petit homme vêtu d'une blouse élimée, qui, le bâton noueux à la main, parcourait l'Alsace avec un immense sac sur le dos. Personne ne lui aurait refusé l'aumône ; il entassait dans son sac les habits usagés que ravaudait sa sœur qui avait une petite échoppe à Zellwiller. Par la suite, il distribua à ses généreux donateurs des cartes postales qui le représentaient avec sa casquette fichée sur la tête, en tenue de travail, ou bien revêtu d'un assemblage un peu hétéroclite, une combinaison des plus beaux habits qui lui avaient été remis ; c'était son Jontef Glaad, son costume des jours de fête. "En ces solennités, hôte honoré, il trônait majestueusement à la table amie, et tous les Juifs de la communauté assemblés venaient prêter une oreille complaisante à ses récits... Il était la gazette vivante et trottinante aux mille oreilles fidèles et averties, contant deuils, mariages et fiançailles..." (4).
Malheur au Juif qui osait se soustraire à l'obligation d'accueillir à sa table l'hôte de passage que la communauté lui envoyait : il risquait de se voir interdire le droit d'être "appelé" à la Torah ou de dire le Kadish aux anniversaires de deuil. On craignait d'ailleurs de mécontenter les pauvres et les mendiants car Dieu ne saurait manquer de châtier ceux dont le coeur est endurci. "Wer net Jakob gebt, gebt Ejsau", "qui ne donne à Jacob, donnera à Esaü" ; celui qui reste sourd au malheur d'autrui, connaîtra lui-même des épreuves et se rendra compte de la vanité des choses.
Si l'urbanisation et l'embourgeoisement assurèrent la promotion sociale des Juifs et une nette amélioration de leurs conditions de vie, ils entraînèrent également un processus de "normalisation". Alors qu'au 19ème siècle les communautés juives d'Alsace ne s'étaient pas engagées dans la voie de la laïcisation, qu'elles étaient restées attachées à une culture qui constituait, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une façon spécifique de vivre son judaïsme, la "normalisation" entraîna en premier lieu une perte de substance religieuse. La ville bouleversa le rythme de la vie quotidienne qui était scandée par les rites et les fêtes, tandis que l'observance du Shabath et des lois alimentaires déclina. L'embourgeoisement et le dépérissement religieux entraînèrent également un relâchement du tissu social. Ce qui caractérisait jusque-là cette communauté campagnarde et extérieurement inculte, ce qui constituait sa principale force c'était sa sociabilité. "Pour être resté longtemps en dehors de la bourgeoisie, le judaïsme d'Alsace n'en a pas adopté les graves travers, l'égoïsme de la libre concurrence, le besoin de sauver la face en affirmant extérieurement une aisance qui n'a pas de correspondance intérieure" (5). Durant la plus grande partie du 19ème siècle, à la campagne, la maison juive était restée largement ouverte, accueillant aussi bien les voisins non-juifs que les colporteurs et mendiants juifs de passage. A l'intérieur même de la communauté juive, il existait une "solidarité très complexe, faite à la fois d'entraide, de charité et d'un sentiment beaucoup plus intime de l'appartenance à une destinée commune. Le village juif d'Alsace peut soutenir, pour l'intensité et le sérieux de sa vie collective, la comparaison avec le Stätdel ("bourgade juive") d'Europe Orientale" (6).
Or, en même temps que s'affaiblissait le judaïsme qui rythmait l'existence, la générosité spontanée envers l'étranger et la solidarité qui s'exprimait dans la quotidienneté, autant qu'à certains moments exceptionnels de la vie, se relâchèrent. Comment ne pas être frappé par l'opposition entre le témoignage de Daniel Stauben (7), qui souligne comment, vers le milieu du 19ème siècle, le Juif le plus pauvre se faisait un point d'honneur d'accueillir à sa table du Shabath les mendiants alsaciens et polonais, et celui de Léon Cahun (8), à peine vingt ans plus tard. C'est l'automne et, à l'approche des "jours redoutables", les pauvres affluent. "On sent que la fête est proche ; déjà les pauvres, hirondelles des jours redoutables, ont fait leur apparition, flairant les soupes grasses et se réjouissant d'avance à la pensée des distributions d'aumônes. Le Goinfre de Wissembourg a reparu, et les Polonais sortent de terre". Mais déjà se manifestent la méfiance envers l'étranger ainsi que la bonne conscience et le mépris condescendant des nantis à l'égard des va-nu-pieds." "On a même vu, depuis deux jours, les guenilles exotiques d'un Iéréchalmé (un habitant de Jérusalem) ; cet homme en longue robe crasseuse a été dévotement logé par le bon Kussel, l'aubergiste-gargotier orthodoxe, qui a toutefois recommandé à sa bonne de donner un tour de clef aux armoires, et de veiller sur la cave. La bonne n'est pas contente : elle a déclaré à son maître qu'elle ne voulait pas de ces pouilleux sans chaussettes dans sa cuisine. Tout le monde, à Hochfelden, se moque de cet étranger, de sa démarche traînante, de sa lenteur orientale, car les bons Juifs, en admettant qu'ils descendent d'ancêtres syriens, se sont un peu dégourdis depuis ce temps-là ; le brave labeur et l'honnête ciel de France les ont rendus lestes et actifs, et ce n'est pas eux qui traîneraient la savate à l'orientale" (9).
Cette méfiance de parvenu peut aller jusqu'aux plaisanteries les plus grossières et les plus cruelles, témoignant d'une sécheresse de cœur sordide. "Et comme il était las des Polak (mendiants polonais), ce farceur de Mayerlé... attira vers la table l'un des compères, et ne manqua pas une si belle occasion de produire un effet. Prenez-vous quelque chose ? Allons, ne vous gênez pas, prenez quelque chose. - Eh bien, tout de même, dit le candide Polonais, en louchant du côté des gâteaux. - Alors, prenez la porte tout de suite, mon ami, riposta Mayerlé au milieu des rires de l'assistance " (10).
Ainsi l'embourgeoisement et la respectabilité entraînèrent parfois l'insensibilité au malheur d'autrui et une suffisance de repus. Alexandre Weill, qui affirme, non sans quelque exagération, que les "lignes de démarcation sociale" sont tranchées chez les Juifs de la campagne alsacienne, reconnaît cependant que, chez les Juifs pieux, une seule noblesse égale toutes les autres, celle de la science talmudique alliée à une grande piété. "Si Elias eût été rabbin, il eût pu, bien que fils de mendiant, élever ses visées jusqu'à Couronne, et même plus haut dans les familles du vieux rite. Mais n'étant que maître d'école, passant pour avoir lu des livres français et allemands, il ne pouvait prétendre qu'à une fille du commun, d'autant que, malgré sa piété officielle et bien qu'il n'enfreignît pas une loi rabbinique, il passait, comme tous les érudits profanes, pour un franc-maçon, ayant des velléités réformatrices, hérétiques et ne croyant pas à grand'chose au fond du coeur" (11). La mutation sémantique du mot Gacht paraît significative de la commisération hautaine à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Cette expression, qui signifie initialement l'hôte de passage, le mendiant errant que l'on accueille à sa table le Shabath et les jours de Fête, et qu'il convient d'honorer, a pour origine le mot germanique Gast, l'hôte. Mais, progressivement, on en vint à mépriser la misère, et l'expression se chargea de connotations péjoratives, pour désigner finalement un parvenu dépourvu de manières, ou encore une personne mesquine, étriquée, qui ne sait pas "ce qui se fait".
 Mendiant juif en Pologne, photographie, 1897 source : MAHJ |
L'accession progressive à la bourgeoisie dans la deuxième moitié du 19ème siècle, l'expérience partagée avec leurs concitoyens de la présence allemande, en même temps que l'essor que connurent les institutions juives durant cette période, donnèrent aux Juifs d'Alsace le sentiment qu'ils étaient définitivement acceptés en tant que citoyens respectables par la société environnante. Un tableau représentant un groupe de femmes et d'enfants traînant un maigre baluchon, d'hommes hâves et voûtés, avec à leur tête un vieillard portant un Sefer, qui avancent péniblement dans la neige, tandis que des cavaliers les molestent, figure certes dans nombre de foyers juifs. Il porte pour légende : "S'Golès", "l'exil". Mais ce tableau ne touche plus la sensibilité des Juifs alsaciens qui ont la conviction qu'ils ont définitivement émergé à la lumière ; il évoque un passé aboli, en même temps qu'une réalité lointaine, presque exotique.
L'attitude de la communauté juive d'Alsace à l'égard des Juifs d'Europe Orientale qui affluèrent à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, fut complexe et dans l'ensemble peu favorable. Le plus souvent apparaissait dans un village un vieillard en long manteau et en bottes, la barbe en broussaille, coiffé d'un chapeau melon ou d'une toque, accompagné d'un jeune homme. Il avait laissé sa famille en Pologne et, comme le sous-prolétariat nord-africain dans l'Occident contemporain, se privait de tout pour envoyer quelques sous à la maison. Certains jours, il venait ainsi huit ou dix mendiants dans un même village et en automne, à l'approche des "jours redoutables", quand les Juifs se rendaient sur la tombe de leurs parents, ou à l'occasion d'un mariage ou d'un enterrement, ils étaient bien plus nombreux encore. Les Juifs de la campagne se plaignaient en disant : "S'ech wieder a Scheffvoll (a Zug) angekomme", "Il y a de nouveau toute une cargaison qui a débarqué", ou bien : "Do kommt schon wieder aner. A teifelvoll Polacken sen do hette", "En voilà encore un. Il y a tout plein de Polak chez nous aujourd'hui. Que le diable les emporte !". Après les pogroms apparurent parfois des chariots, tirés par un cheval, où s'entassaient des familles entières, vieillards, femmes, enfants, dans le plus grand dénuement.
Jusque vers 1880 a prévalu, dans certaines communautés d'Alsace, la dîme. Chaque chef de famille versait, selon l'obligation religieuse, un dixième de son gain afin de secourir les pauvres. Ce système d'entraide était d'autant plus remarquable que la misère était grande dans les villages d'Alsace. Par la suite, on constitua dans les communautés une caisse de secours à laquelle chaque famille versait une cotisation mensuelle. Les pauvres de passage s'adressaient au trésorier qui leur remettait leur Tsedoke, "aumône" ; certains se hâtaient afin d'effectuer ainsi la visite de plusieurs communautés le même jour ; d'autres préféraient poursuivre leur tournée de maison en maison, malgré l'opposition des notables qui affirmaient qu'en parcourant les rues ils suscitaient de l'antisémitisme : "Sie mache rechess". Durant la semaine, à midi ou le soir, ils étaient le plus souvent invités à partager le repas de la famille chez qui ils se trouvaient. Le vendredi après-midi on leur remettait un Blett (billet) qui leur indiquait la famille qui était prête à les accueillir pour le dîner ou pour le déjeuner du Shabath. En effet, chaque foyer de la communauté, dans la mesure de ses moyens, invitait à tour de rôle les mendiants de passage. Lorsque les mendiants devinrent plus nombreux on se contenta, durant la semaine, de leur donner quelques Pfennig ; cette maigre somme représentait le prix d'un œuf en été ou d'un demi-verre de bière, ou encore le huitième du prix d'une miche de trois livres.
Les communautés qui n'avaient pas de Schlaufstätt (asile de nuit) logeaient les mendiants dans les pièces les plus obscures de l'auberge juive ou le plus souvent dans la grange des fermiers et des marchands de bestiaux. Ils dormaient dans le foin ou la paille, et en hiver, par les grands froids, non loin des bêtes dans l'étable. Parfois les enfants s'approchaient des familles qui bivouaquaient dans la cour, ou encore ils écoutaient avec émerveillement, le vendredi soir, autour de la table familiale, les récits évoquant des contrées lointaines et aussi la Terre Sainte ; parfois ils se tenaient à distance car, quand ils n'étaient pas sages, on leur faisait peur en les menaçant de les abandonner aux Polak. A Pourim certains enfants se déguisaient en Polak ; ils revêtaient un vieux pardessus, arboraient un chapeau cabossé et une barbe en broussaille et portaient sur leur dos une vieille valise.
- Journal de Joseph Lehman, autrefois au Musée Alsacien de Strasbourg
- Alexandre Weill, Couronne 1, Paris 1878, p.37
- Ibid. 2, p.46-47
- Mauschélé Zellwiller, Ernest Ginsburger
- André Neher, L’existence juive, Paris 1962, p.240
- Ibid. p.241
- Scènes de la vie juive en Alsace, Paris 1860, p.57-58
- La vie juive, Paris 1866, p.84
- Ibid. p.126-127
- Ibid. p.80
- Alexandre Weill, Couronne 1, Paris 1878, p.58