 |
"Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons
le poids" Jean Samuel |
Cliquez pour entendre le premier récit fait par Jean Samuel de ses années de déportation, 36 ans après sa libération des camps nazis. Le texte que vous entendez est différent de celui que vous pouvez lire ci-dessous - © ASIJA |
avec l'aimable autorisation de l'Editeur.
Propos recueillis par Claude RIVA le 22 février 2002, transcrits par Marie-Hélène SABARD
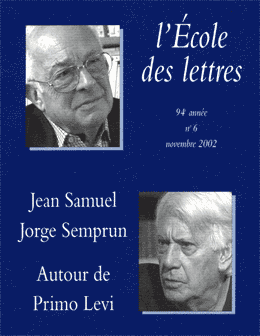 Jean Samuel. – En mars 1946, quand nous nous sommes retrouvés, Primo Levi m'a écrit : "Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids." En effet, lui avait commencé à écrire et à témoigner dans les écoles, les lycées, les collèges, tandis qu'à moi, il m'a fallu à peu près trente-cinq ans pour pouvoir enfin parler, raconter…
Jean Samuel. – En mars 1946, quand nous nous sommes retrouvés, Primo Levi m'a écrit : "Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids." En effet, lui avait commencé à écrire et à témoigner dans les écoles, les lycées, les collèges, tandis qu'à moi, il m'a fallu à peu près trente-cinq ans pour pouvoir enfin parler, raconter…
Aujourd'hui, comme chaque fois que je témoigne, je pense à tous ceux qui sont restés à Auschwitz : juifs, tziganes, résistants, homosexuels… Plus d'un million de personnes – le chiffre exact, on ne le connaîtra jamais – arrêtées, déportées, souvent gazées le jour même de leur arrivée. Je pense en particulier à ma famille proche, arrêtée en même temps que moi : mon père, un jeune frère de dix-sept ans, Pierrot, trois oncles et deux femmes – ma mère et une cousine. Étonnamment, les deux femmes sont rentrées…
Quoi qu'on fasse, on ne peut pas oublier. J'essaie de témoigner – je continuerai tant que je le pourrai. Et je vous remercie de m'en donner l'occasion car ce ne sera pas éternel : nous avons, nous tous qui témoignons en ce moment, ce problème de la transmission. C'est probablement grâce aux initiatives comme la vôtre que nous aurons une chance de survivre et de témoigner de notre histoire.
Ils sont arrivés avec une petite camionnette et ont fait un tri dont j'ignore les raisons : ils ont choisi huit personnes – il n'y avait pas plus de places dans leur camionnette – sur les dix-huit membres de ma famille qui habitaient cette grande maison. Nous avons été emmenés en prison à Agen, puis à Toulouse, tout près de l'université où j'avais fait mes études, et ensuite à Drancy, dix jours. Le 27 mars 1944, nous avons quitté Drancy par le soixante-dixième convoi – sur les soixante-quinze partis entre mars 1942 et juillet 1944.
À ce propos, je voudrais tout de même donner quelques chiffres : 76 000 Juifs ont été déportés depuis Drancy et, en 1945, nous sommes rentrés très exactement 2 251. Ce ne sont que des chiffres mais, derrière les chiffres des personnes manquantes -soit près de 74 000 -, il y a des bébés, des enfants, des adultes, des malades, des personnes âgées… Il ne faut pas oublier cela : c'est essentiel.
L'École des lettres. – Pourriez-vous préciser la spécificité du camp où vous vous trouviez dans le complexe d'Auschwitz ?
Jean Samuel. – Bien sûr. Il y avait essentiellement trois grands camps autour d'Auschwitz, et facilement une quarantaine, ou peut-être plus, en Haute-Silésie. Je suis arrivé à Auschwitz 1, une caserne qui existe encore aujourd'hui et où se trouve le musée. À Auschwitz 1, il y avait de trente-cinq à quarante mille personnes. Dans mon camp de Buna-Monowitz, qui devait fournir de la main-d'œuvre à l'IG Farben, nous étions entre dix et quinze mille. Vingt-cinq mille STO, des jeunes du Service du Travail Obligatoire venus de toute l'Europe travaillaient dans la même usine. J'y ai d'ailleurs rencontré un garçon que je connaissais de Villeneuve-sur-Lot. Il a pu faire passer un message chez moi, avec des risques pour lui comme pour moi, puisqu'il était absolument interdit de nous parler.
Il y a aussi le camp de Birkenau. C'était celui où se trouvaient les femmes et les Tziganes, qui étaient restés en famille : eux ont été vraiment liquidés, au mois d'août 1944, je crois. C'était un camp immense, qui comptait de quatre-vingt-dix à cent mille personnes, dont toutes les femmes, puisque, à ma connaissance, il n'y en avait pas ailleurs. Ma mère s'y trouvait. Elle était face aux crématoires – les chambres à gaz, on ne les voyait pas. Jusqu'à sa mort – et elle est morte à quatre-vingt-un ans –, presque chaque nuit elle a fait ce cauchemar des flammes des crématoires… Moi, je ne les ai jamais vues. Je ne dirai jamais que ça a existé, puisque je ne les ai pas vues personnellement. Tout ce que je peux dire, c'est que, de temps en temps, quand le vent venait de l'ouest ou du nord-ouest, on sentait des odeurs terribles. Mais je n'ai jamais vu les flammes du crématoire. Je n'en parle donc pas.
Mon camp de Monowitz, qui était Auschwitz 3, était un camp de travail où l'on mourait, où l'on disparaissait. On n'était pas toujours sûr que quelqu'un mourait. Un de mes oncles est parti au mois de juillet. Je ne sais pas où il est allé, je ne suis pas sûr qu'il ait été gazé tout de suite : il a peut-être été envoyé dans l'un des multiples petits camps, mines, usines métallurgiques, carrières, etc., qui composaient l'ensemble des camps dit "Auschwitz". Mon camp de Monowitz a été détruit tout de suite après la guerre. C'était un champ… Aujourd'hui, c'est un quartier d'habitation.
 |
Je crois qu'il faut insister sur un point : seul le hasard, avec une certaine envie de vivre tout de même, a permis notre survie - oui, le hasard, les chances, connues ou inconnues, celle-là étant probablement la plus "parlante", la plus évidente, d'un hasard heureux ayant permis la survie. Voilà. Ma mère a eu un parcours très compliqué : à la fin, elle est allée à Ravensbrück et a été libérée par les Russes, sur l'Elbe, un mois après moi. Elle est rentrée et a vécu encore trente-trois ans…
Au nombre des chances, j'ai eu aussi celle de tomber sur un jeune homme chargé de nous demander nos métiers. Je lui ai dit que j'étais étudiant en pharmacie. Il m'a répondu : "Ca, c'est inutile. Tu n'as pas autre chose à me proposer ?" Or, de 1940 à 1943, j'avais fait des études de pharmacie à Toulouse et, le temps des étudiants étant très libre pendant la guerre, j'avais aussi passé une licence de sciences - botanique, mais surtout mathématiques et plus encore chimie générale. Alors j'ai ajouté : "J'ai fait une licence de sciences : chimie." Et il m'a répondu : "Ah ! ça, ça pourra peut-être te servir." Cette licence a sans doute été un facteur essentiel de ma survie…
C'est pourquoi je voudrais insister sur la question de la chance. Personne n'est rentré parce qu'il était intelligent ou parce qu'il était fort. Non, il a fallu des chances – tout le temps, tous les jours –, des chances que l'on connaît et d'autres qui nous sont inconnues. Nous n'avons absolument aucun mérite à être revenus.
D'un autre côté, ça peut peut-être aussi nous déculpabiliser un peu : si nous n'avons rien commis d'irréparable, on peut penser que nous ne sommes pas coupables, pas tous… Nous ne pouvons pas nous sentir absolument coupables d'avoir survécu parce que nous ne sommes pas – nous n'étions pas – maîtres de la situation.
Jean Samuel. – De ma mère, tout de suite. Nous avons tout de suite été séparés des femmes. Mon père est resté à Auschwitz, à six kilomètres : il y est mort. Six kilomètres, c'est pire que la Lune. Nous n'avions aucune possibilité d'obtenir des renseignements. Je sais que mon jeune frère vivait encore le 19 janvier, grâce au témoignage, obtenu en 1946, d'un médecin qui se trouvait dans le camp de travail où il avait été envoyé avec quarante-neuf autres personnes de mon convoi huit jours après notre arrivée. Comme mon frère était très grand - un mètre quatre-vingts - et costaud, il avait été envoyé dans une carrière de pierres pour faire du ciment.
Je vais vous donner un autre exemple extraordinaire de qui pouvait survivre. Il y a trois ans, j'ai retrouvé par hasard dans l'un des rares documents du camp restant à Auschwitz la liste des cinquante personnes de mon convoi, dont faisait partie mon frère. Sur ces cinquante personnes - j'ai contrôlé dans le livre de Klarsfeld -, deux ont survécu : l'un était né en 1900 et l'autre en 1893. C'étaient les plus âgés. Alors que mon frère était né en 1926 et que c'était une force de la nature…
Des autres je ne sais rien : le seul que j'ai vu mourir, c'est un oncle qui m'a très difficilement accompagné jusqu'à Buchenwald et qui est mort là-bas.
Jean Samuel. – Pendant trois heures, la nuit, dans Auschwitz 1, j'ai été lavé et rasé, comme tout le monde, avec des lames Gillette qui avaient déjà servi des milliers de fois et qui nous ont laissés rouges comme des écrevisses. J'ai été tatoué d'un numéro sur le bras, je peux vous le montrer. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas douloureux en soi. Mais, plus qu'un numéro, c'était notre identité au camp. Ce n'est pas le tatouage en soi qui est important, mais la perte d'identité. Il était difficile d'accepter de s'appeler "176397". Ce numéro, il restera sur mon bras tant que je vivrai. Au camp, on ne connaissait que les numéros. Pour les tout proches seulement on savait vaguement un prénom, un surnom, un nom…
Du temps où j'étais Pikolo, j'ai fait une comptabilité du Kommando de chimie et, plutôt que les noms, je me rappelais les numéros. Je me souviens parfaitement du numéro de Primo Levi : le 174517. Je me souviens de celui de mon père, un numéro avant moi : 396, de celui de mon frère, le 398, de mes oncles : 447 et 448. Je me rappelle un certain nombre de noms de là-bas, de numéros qui étaient notre nom. Nous avons eu beaucoup de mal à nous habituer à cette perte d'identité. Pour cette raison, il était important d'avoir des camarades - quelques-uns -, dont on connaissait le nom, le prénom parfois : c'était essentiel pour garder un minimum d'humanité. Être un numéro, ça veut dire ne plus être un homme.
C'était le but des Allemands, d'abord pour eux-mêmes, dans leurs rapports avec nous : il était plus facile de tuer un numéro que de tuer un être humain. Et, pour nous, il était plus dégradant d'être un numéro, comme un bétail, comme un bœuf dans un troupeau, marqué à vie d'un numéro que l'on portait non seulement sur le bras mais aussi ailleurs, dans sa tête.
| Page suivante |
 |
© A . S . I . J . A .