 |
"Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids" - Jean Samuel (suite et fin) |
Je voudrais tout de même vous dire quelques mots de la "Marche de la mort", car ç'a été un épisode terrible pour nous tous. Nous avons été lancés sur les routes en sabots, sur vingt centimètres de neige, par –25° C, à peine habillés, presque squelettiques - nous pesions entre trente-cinq et quarante-cinq kilos. Et nous avons réalisé un exploit auquel je n'arrive toujours pas à croire : nous sommes partis le jeudi 18 dans l'après-midi et, jusqu'au lendemain matin six heures, nous avons parcouru quarante-deux kilomètres. Je marchais entre mon oncle et un jeune mathématicien avec qui nous avons parlé du grand théorème de Fermat. On se donnait tous le bras parce que, dès que quelqu'un quittait la colonne, deux minutes après on entendait un coup de feu. Nous avons laissé des milliers, des dizaines de milliers de morts le long des routes de Haute-Silésie. Nous nous sommes reposés trois ou quatre heures, puis nous sommes repartis et nous avons encore fait vingt-cinq kilomètres jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire qu'en un peu moins de quarante-huit heures, nous avons parcouru soixante-sept kilomètres à pied.
Je crois qu'il n'existe pas d'explication physiologique ou médicale à ce que l'homme peut faire. Mais il y a en chacun une envie de vivre, de survivre qui, sans être consciente, permet des choses qui semblent impossibles, incroyables. Après, nous avons voyagé cinq jours et cinq nuits à cent dix personnes dans des wagons découverts, debout, à travers la Haute-Silésie et la Tchécoslovaquie jusqu'à Buchenwald, où nous sommes arrivés le 26 janvier, peu nombreux, avec des morts dans les wagons. Nous étions partis le 18…
Je ne suis retourné à Auschwitz qu'en 1995. J'avais organisé un colloque au Conseil de l'Europe, à Strasbourg . J'y suis allé non pas pour le cinquantième anniversaire de la libération des camps, mais pour rappeler le début de la "Marche de la mort".
Nous avons été mis dans un camp à l'ouest, à vingt-cinq kilomètres dans la montagne, à travailler très dur. J'ai été libéré à la suite d'aventures rocambolesques. Nous avons pu réussir à nous maintenir au camp de Buchenwald, à ne pas repartir sur les routes, alors que la plupart des gens qui se trouvaient au petit camp sont repartis. Et j'ai été libéré en même temps que Jorge Semprun, le 11 avril 1945…
 |
Nous nous sommes revus pour la première fois en 1947, entre Menton et Vintimille - en hommes, avec des cheveux, et un visage à peu près normal. Après, nous nous sommes revus très souvent, chaque fois que ma femme et moi nous rendions en Italie ou que lui passait en Alsace, jusqu'à la dernière fois, en 1985, un an et demi avant sa mort.
Je pense vraiment que, s'il a survécu, c'est pour témoigner. Je suis sûr que, pour lui, c'était extrêmement important. Et il avait cette mémoire fantastique qui lui a permis de se remémorer toutes ces histoires. Quand il m'a envoyé cette liste, j'étais ahuri de constater que, souvent, en parlant d'un camarade, il savait son nom, son prénom, d'où il venait, parfois son métier, approximativement son âge, alors que chacun essayait de cacher sa vie - il était trop pénible d'en parler…
À ma connaissance, c'est un phénomène unique. C'est pour cette raison aussi que ses livres ont une telle importance : parce qu'il est la mémoire de beaucoup de gens. J'ai ma mémoire à moi, mais Primo a conservé la mémoire de dizaines et de dizaines de personnes. Et cette mémoire durera. Primo Levi sera certainement l'écrivain qui nous survivra à tous, et aussi aux critiques littéraires…
Dans le film consacré à la déportation en 1955, Nuit et Brouillard, d'Alain Resnais, il n'est pas question un instant de ce qui s'est passé à Auschwitz. C'était tabou. Il faut dire aussi que nous n'étions pas gâtés : à ce moment-là, on nous a appelés "déportés raciaux" - ce n'était pas un titre très engageant pour parler. Il a fallu de longues années pour effacer l'image de la non-résistance : la résistance était individuelle, elle ne pouvait pas être autre. Nous n'avions aucun moyen de nous révolter physiquement ou avec des armes, comme ça s'est passé dans d'autres camps. Ça a été long à faire admettre.
 |
L'amitié, c'est ce dont je parle le plus souvent, je crois. Une amitié est rare. On ne pouvait pas avoir beaucoup d'amis : trois ou quatre au maximum. Il était impossible d'en avoir beaucoup : on ne pouvait pas se disperser. Sans le soutien de l'amitié, personne ne serait rentré. Tous ceux qui sont rentrés ont eu, à un moment ou à un autre, des amis - d'une amitié qui n'existe pas dans la vie de tous les jours.
Mon dernier camarade venait d'Auschwitz-Buna comme moi. C'est lui qui a repris la place de mon oncle et qui m'a soutenu pendant les trois derniers mois. C'était un jeune Parisien, juif, résistant. Le 27 mars était le jour de l'anniversaire de sa fiancée et, pour moi, le jour anniversaire de notre départ de Drancy. Ce 27 mars-là, dans le camp où nous nous trouvions, à vingt-cinq kilomètres à l'ouest de Buchenwald, il m'a coupé une tranche presque transparente de son petit bout de pain, et moi je lui ai donné une pointe de couteau de la confiture qu'on avait reçue ce jour-là. Eh bien, aucun cadeau, quel qu'il soit, de ma famille, de ma femme, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, ne pourra jamais égaler ce moment-là. Je pense que c'est peut-être cela qu'il faut retenir - pas seulement les horreurs, mais aussi la force, la puissance de l'amitié, une amitié qui est difficile, qui n'est pas de tous les instants, mais qui constitue pour moi un élément positif.
L'École des lettres. – Depuis quand témoignez-vous ? Jean Samuel. – Depuis la mort de Primo. Avant, je témoignais dans un cercle restreint : la famille, les amis, etc. C'est après la mort de Primo que j'ai témoigné publiquement. La première fois, c'était rue de Varenne, à l'Institut culturel italien, un an après sa mort. Il y avait Ferdinando Camon, le directeur de la Stampa, un professeur de l'université de Paris, un poète d'origine égyptienne mort peu après, Edmond Jabès. Je n'avais rien préparé, et je voyais que tous avaient un texte. Alors j'ai parlé - pour la première fois. Ce n'était probablement pas très bon, mais enfin… c'était naturel et c'est sorti… Depuis j'ai pris l'habitude de parler sans texte, en oubliant parfois des choses qui me semblent importantes, mais on ne sait jamais ce qui l'est vraiment. Je crois que c'est plutôt le fait de parler qui compte : après, à chacun d'en tirer ce qu'il juge important.
On m'interroge aussi sur mes rapports avec les Allemands, avec l'Allemagne d'aujourd'hui. À cela je réponds toujours que ce serait donner, après coup, raison à Hitler que d'en vouloir aux enfants ou aux petits-enfants des gens qui nous ont fait tant de mal – et pas seulement à nous, à toute l'Europe.
Oui, pourquoi leur en voudrais-je ? Je suis allé témoigner dans des lycées allemands, j'ai des contacts avec l'université de Fribourg, j'ai parlé à des hommes, des femmes, des enfants de plus quinze ans. Cela ne me pose aucun problème.
Cet instant, heureusement pour moi, aujourd'hui je ne peux plus me le rappeler. C'est bien de ne pas pouvoir se remettre dans cette situation. Mais il y a des gens, des camarades, qui ne sont jamais sortis d'Auschwitz – c'est terrible, on ne peut rien pour eux…
"Mon cher Jean,
À bien y regarder, l'amitié qui nous lie est quelque chose de bien étonnant et unique. Nous nous sommes connus dans des circonstances particulières, à peu près dans la condition la plus misérable où on pourrait jeter un homme. Nous nous sommes trouvés associés dans notre lutte contre la Vernichtung [l'anéantissement] non seulement matériel, mais surtout spirituel, par le Lager [le camp]. Nous avons été sauvés par le hasard, par deux processus extrêmement improbables et nous sommes retrouvés au-delà de tout espoir. Avec ça, nous ne savons pratiquement rien l'un de l'autre, ce qui rend particulièrement amusant et émouvant de s'écrire et de se lire. Comme il serait plutôt gênant et inconfortable de te décrire per extenso qui est monsieur Primo Levi, je t'envoie trois poésies et l'un des contes que j'ai écrits en échantillon de moi-même. Ce n'est pas des meilleurs, mais je t'envoie celui-ci parce qu'il y est question de toi. Je l'ai écrit quand j'étais bien loin de soupçonner que tu étais en vie et que tu aurais eu l'occasion de le lire, et je t'assure que je n'y ai changé mot. Je te demande pardon des inexactitudes et de tout ce qui pourrait de quelque façon te choquer. J'espère que tu comprendras mon italien.
À propos de l'atome de carbone, j'avais oublié, non pas l'idée, mais d'en avoir parlé avec toi. Je n'ai pas abandonné le projet, mais je me trouve trop plongé dans les soucis matériels et les souvenirs récents pressent dans ma mémoire. Quand je serai vieux, peut-être, et si je n'aurai pas été trop usé par la vie."
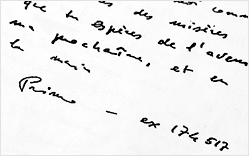 Il
m'avait dit un jour de juillet-août 1944 qu'il avait l'intention d'écrire
un roman de l'atome de carbone. Primo Levi aurait donc sans doute été
écrivain sans Auschwitz, mais assurément pas le même écrivain.
Finalement, il n'a jamais écrit ce roman, mais l'idée a clos le
dernier chapitre du Système périodique, où il termine
par le carbone du point final avec le crayon qu'il a utilisé pour écrire.
Tel a été le devenir de son projet initial, d'avant la déportation,
d'écrire un jour l'histoire d'un atome de carbone. Laissez-moi encore
vous lire simplement le Nota Bene, après sa signature : "Tu
serais bien gentil de me signaler mes fautes de français."
Il
m'avait dit un jour de juillet-août 1944 qu'il avait l'intention d'écrire
un roman de l'atome de carbone. Primo Levi aurait donc sans doute été
écrivain sans Auschwitz, mais assurément pas le même écrivain.
Finalement, il n'a jamais écrit ce roman, mais l'idée a clos le
dernier chapitre du Système périodique, où il termine
par le carbone du point final avec le crayon qu'il a utilisé pour écrire.
Tel a été le devenir de son projet initial, d'avant la déportation,
d'écrire un jour l'histoire d'un atome de carbone. Laissez-moi encore
vous lire simplement le Nota Bene, après sa signature : "Tu
serais bien gentil de me signaler mes fautes de français."
C'était Primo – un homme tellement simple, tellement intelligent,
et tellement gentil : un ami.
| Page précédente | Début du dossier |
 |
© A . S . I . J . A .