Dans l'interview qu'il accorde en 1931 à Frédéric Lefèvre, André Spire se donne pour un poète "dévoré par l'action". Pour lui, le dilemme baulelairien n'existe pas : l'action est "la sœur du rêve" et, même quand elle le déçoit, la source de son inspiration. Aussi est-il impossible à qui veut comprendre l'évolution poétique d'André Spire, et d'abord la formation de sa personnalité, de faire abstraction des activités sociales qu'il assuma, depuis son entrée au Conseil d'Etat, pendant plus de quarante années. Telle n'est pas la moindre caractéristique de son originalité. Chez Spire l'action et la création, une seule vocation les commande : nécessité de tout l'être, aspiration morale plutôt qu'esthétique, besoin du cœur en un mot.
 |
Sa philosophie aussi avait changé. Il n'hésitait plus à reconnaître qu'il ne croyait pas en Dieu. Un problème avait d'abord subsisté (car décidément il n'était pas un sceptique), celui du fondement de la morale. Mais ses études juridiques et économiques lui avaient enseigné que la décadence morale précède toujours l'écroulement des sociétés. L'individu a intérêt à se régler sur l'intérêt social qui veut que la justice règne. L'intérêt social dicte à l'individu charité, abnégation, fraternité. André Spire retrouvait ainsi l'Evangile. Il retrouvait l'inspiration de Tolstoï, dont le Roman russe de Melchior de Vogüé lui avait appris le nom dès 1886 et dont les oeuvres, une à une traduites, de plus en plus répandues en France, l'avaient bouleversé.
C'est dans cet état d'esprit que le jeune auditeur eut à subir l'offensive des marieurs et des marieuses, qui lui offraient, non pas des épouses, mais des dots et l'annexion de sa personne par de richissimes familles d'industriels, de savants réputés, de puissants hommes d'affaires, de hauts magistrats. C'était bien là cette "élite", cette "ploutocratie judéo-chrétienne" qu'il n'avait cessé de fuir! Etait-ce pour en arriver là qu'il avait suivi tant de cours fastidieux, affronté tant d'examens, travaillé dans des directions si opposées à sa nature ? Il repoussa les assauts, déjoua les manoeuvres, usa de rouerie, d'effronterie, se fit passer pour un insolent, pour un fou. Sa victoire ne fut définitive qu'après un éclat qui scandalisa ses parents et les brouilla, en même temps que lui, avec la cohorte effarée de ces "proxénètes mondains" animés d'intentions si pures.
Celle campagne de marchandages avait duré plus d'un an ! Elle n'avait
pas empêché André Spire de préparer et de soutenir
sa thèse en droit. Depuis qu'il était en âge de réfléchir
sur les événements, le Boulangisme, puis le scandale de Panama
avaient secoué la République.
André Spire ne pouvait pas demeurer indifférent au climat de lutte
politique qui s'instaurait dans notre pays. Pourtant, ce qui le touchait au
point le plus sensible, c'était le réveil de la lutte sociale
auquel il assistait. Au cours d'une interview aux Nouvelles Littéraires,
il évoque cette période troublée: "bombes tous les
matins aux quatre coins de Paris, fermeture de la Bourse du Travail, le Quartier
Latin bouleversé par les fausses émeutes fomentées par
la police " ! Cette émotion, ce n'était pas l'agitation qui
la provoquait, mais l'atroce misère que l'agitation révélait.
Et il consacra aux attentats anarchistes de 1891 et 1892 une partie de sa thèse
: imposant volume de plus de deux cent soixante pages in octavo sur
la Responsabilité des Communes en cas d'attroupements, dont
le professeur Lehrmann, de l'Université de Lausanne, devait écrire,
en 1938, que "dans le monde impassible du Droit" l'auteur avait introduit
"la vie ardente".
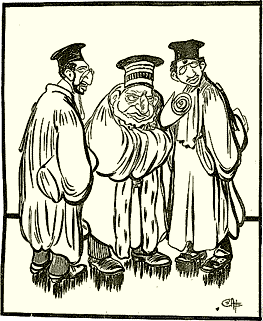 |
André Spire ressentit l'injure comme il la ressentait à douze ans dans la cour du lycée de Nancy. Mais il ne s'agissait plus de petite guerre, ni comme à Soleure d'une querelle d'enfants, même grave. L'affront, doublé de perfidie, dépassant sa personne, relevant d'un plan d'ensemble, visait à salir tous les Juifs et par surcroît éclaboussait la grande maison où il était entré un an plus tôt avec toute sa loyauté passionnée de justice. La lettre que Spire écrivit le 10 janvier 1895 à ce Nangis, pour obéir à sa colère selon ce qu'il estimait son devoir, conscient des conséquences probables d'un tel acte, mais fort de l'assentiment d'un camarade de promotion et d'un collègue de la promotion précédente, tous les deux non-Juifs, et d'ailleurs prêts à l'assister, cette lettre, est recopiée ci-dessous in extenso :
"Monsieur, la juiverie n'a rien à gagner, l'épargne française rien à craindre de la présence de Juifs au Conseil d'Etat. Les Juifs qui ont l'honneur d'appartenir à ce Corps décident et jugent en obéissant à leur conscience, non à l'intérêt de leurs coreligionnaires. Je constate qu'une fois de plus votre journal met au service de sa détestable cause l'inexactitude, ou plutôt le mensonge volontaire. En 1893, trois juifs candidats (et non six) sur 19 (et non 11) : deux reçus, c'est vrai. En 1894, quatre juifs candidats (et non 7), un reçu (et non 2), 21 candidats (et non 12). Lisez bien reçus, non nommés ; la porte de l'auditorat n'est ouverte que par le concours. Les auditeurs juifs doivent leur situation à leur travail, non à leurs appuis. Je vous requiers d'insérer et vous prie d'agréer j'assurance de mon peu d'estime."Le lendemain matin, André Spire recevait dans son petit appartement de la rue de Grenelle la visite des témoins d'Albert Monniot, autrement dit de Nangis, et refusait toute rétractation écrite ou orale. La rencontre eut lieu le surlendemain dans l'île de la Grande-Jatte. Bien qu'il n'eût rien à léguer à personne, il avait pris la précaution de rédiger son testament. "Si je meurs demain, disposait-il, je désire qu'un prêtre de chaque religion suive mon convoi, le rabbin au milieu." Et il demandait à ces étranges invités de s'entretenir, en marchant, du mal que les religions avaient fait et du bien qu'elles auraient pu faire.
Les conditions du combat étaient dures. L'offensé, qui avait choisi l'épée, ressemblait moins à un journaliste qu'à un bretteur. A la deuxième reprise André Spire reçut, selon sa propre expression, "trois centimètres de fer dans l'avant-bras", ce qui détermina une hémorragie veineuse et mit fin au duel.
Le même jour, 12 janvier, le Conseil rendait son arrêt dans l'affaire des Grandes Compagnies. L'Etat perdait. Raynal menacé de la Haute Cour, Barthou, qui l'avait soutenu, donnait sa démission, et quarante-huit heures après lui, Casimir Périer, Président de la République.
Cet épisode, en dépit des éloges qu'il lui valut, ne détourna pas André Spire de sa vocation sociale. Il s'était lié d'amitié avec un jeune catholique, René Bazin, dont il avait fait la connaissance à l'école de la rue Saint-Guillaume et qui avait été reçu en même temps que lui au Conseil d'Etat. René Bazin n'avait en commun avec le romancier des Oberlé que le nom et le prénom. Il appartenait à une famille de magistrats provinciaux et, bien qu'il eût été élevé par des prêtres, n'avait pas tardé à perdre la foi. Fidèle aux principes de l'économie politique libérale que lui avaient inculqués ses maîtres, Bazin ne concevait pas que l'Etat pût intervenir dans la vie des industries. Si d'autre part il avait cru la classe ouvrière capable d'arracher elle-même au patronat. Dès janvier 1896, ils fondaient la Société des Visiteurs, "sorte de précurseur, a dit Spire depuis, de notre sécurité sociale"
Les adhérents, recrutés parmi des personnes de toutes les religions et de tous les partis, "pourvu que le sectarisme ne les aveuglât pas", avaient mission, non de distribuer les aumônes, mais d'apporter aux travailleurs, que la maladie, un accident, le chômage avaient privés de leur gagne-pain, une aide matérielle et morale qui leur permît de retrouver du travail, de se reclasser dans leur métier. Tel était l'esprit de cette œuvre qui pendant de longues années prouva son efficacité. Esprit dont, rétrospectivement, Daniel Halévy put écrire, dans un brillant article d'un Hommage à André Spire, édité en 1939 pour la librairie Lipschutz, "que c'était un esprit de charité créatrice".
Malheureusement, il y a dans toute œuvre une contrepartie de quotidien,
un train-train de petites besognes dont un homme comme Spire a vite l'impression
qu'il n'est pas fait pour les assumer. Parallèlement cet homme constate,
malgré la qualité des résultats, que le "personnel
de la philanthropie" est plutôt médiocre, et il s'en fatigue.
Il cherche avec anxiété de véritables dévouements,
des dévouements créateurs, dans le style du sien. Par contre,
il ne peut pas les ignorer, ces ambitieux, qui ne se sont glissés dans
la Société que pour y approcher tel ou tel "personnage considérable".
Quoi d'étonnant si André Spire, sans déserter une œuvre
dont il était l'âme, insensiblement s'en détacha ?
Janvier 1898. La campagne pour la "révision" durait depuis plus d'un an. Dreyfusards, antidreyfusards s'affrontaient. Les arguments ne portaient plus, tant c'était affaire de passion. Les crieurs d'éditions spéciales s'essoufflaient sur les boulevards pour arriver les premiers aux terrasses des grands cafés. Partout des groupes se formaient. Brusquement, une bombe : J'accuse, de Zola ! Stupeur dans un camp, délire dans l'autre. Enfin on allait voir clair. Jusqu'alors l'affaire Dreyfus n'avait guère intéressé, en les mettant aux prises, que la bourgeoisie bonapartiste ou monarchiste et la bourgeoisie libérale. Cette fois elle atteignait le peuple. Il comprenait que les classes dirigeantes avaient menti pour conserver à une caste d'officiers la domination de l'armée, et qu'elles menaçaient la République. Mais que pouvait le peuple contre le mensonge ? L'instruction que lui mesurait l'Etat dans les écoles était trop fruste, trop bassement pratique, trop "asservie", selon une formule de Spire, "aux aveugles forces sociales", pour développer son jugement et lui apprendre à reconnaître, sous les déclarations pompeuses, la duplicité des faux patriotes.
De son côté, la bourgeoisie libérale, que la classe ouvrière avait soutenue et soutenait encore dans sa lutte pour la vérité, était prête à partager avec elle son savoir, sa culture. C'est ainsi qu'André Spire fut invité à prendre part aux premières réunions d'une société qu'avait fondée dans le faubourg Saint Antoine un ancien ouvrier libertaire, Georges Deherme, pour établir entre travailleurs et intellectuels une profitable Coopération des Idées. Cette œuvre se rattachait au mouvement des Universités populaires qui levait bientôt rayonner sur l'ensemble du pays.
André Spire ne pouvait manquer de s'enflammer. Passer de la charité à la collaboration avec une organisation ouvrière, quelle occasion pour lui de perfectionner son travail social ! Mais la Coopération des Idées lui proposait un champ d'activité limité et il assistait aux séances de comité d'autres universités populaires de Paris d'où lui venaient des appels Ce fut sans cloute dans l'un de ces comités qu'il rencontra pour la première fois Daniel Halévy, précisément en 1898, en pleine bataille dreyfusarde. Celui-ci crayonna ce portrait en 1939 : "Un Spire très différent de celui que vous connaissez aujourd'hui, un Spire, svelte et fluide, mince comme un page, avec une très légère barbe blonde et d'immenses yeux bleus, tantôt indignés, tantôt émerveillés, constamment éblouis."
Leur amitié naquit dans l'action, en même temps que l'Université Populaire dont ils dotèrent le 18ème arrondissement : l'Enseignement Mutuel. De cœur et de tête, Spire était toujours "l'homme de la Société des Visiteurs", et Halévy, (avec quarante et un de recul), affirma, non sang quelques nuances, il est vrai : "Je pense que notre Enseignement Mutuel peut être assez bien défini comme une section intellectuelle de la Société des Visiteurs." Ce qui signifie certainement qu'à l'aumône d'un enseignement dogmatique les fondateurs préféraient l'esprit créateur d'un enseignement libéral. Ils voulaient inciter les sociétaires à la recherche et à l'étude personnelles, les aider à développer leurs facultés critiques et leur sensibilité. Enfin le mot "mutuel", faisant écho à "coopération", impliquait qu'entre les membres de la société il y avait échange. Le programme tenait dans cette devise : "Elargir le cœur, élever la pensée et la conduire plus avant vers la vérité".
Le local trouvé, l'installation ne traîna guère. 41 rue de la Chapelle, au fond de la cour, au rez-de-chaussée : une chambre en longueur, une profonde alcôve, un "mélancolique espace que la concierge appelait jardin". André Spire était bon ouvrier : l'alcôve devint bibliothèque, la chambre salle de conférences. "Et le quartier fut invité". Croyons-en Daniel Halévy, le quartier vint : "Quel mouvement dans notre petite salle, que d'énergiques jeunes têtes à nos soirées, en été, attentives, sous les étoiles, dans le pauvre jardin." Puis ce raccourci, comme en rêve: "Que d'idées essayées." Car il en passa des porteurs d'idées ! Il en passa des groupements! Libertaires avec les Idéophages, mystiques avec le P. Hyacinthe, mages avec le Sar Péladan. (....) En somme, pour nos meneurs de jeu, une vie intense, où les joies s'achetaient de tracas, quelquefois de drames.
Plus André Spire se sentait "pris, corps et âme", par ce "grand courant de solidarité", plus le service qui au Conseil d'Etat "cantonnait les jeunes auditeurs dans l'étude de minuscules affaires" lui paraissait "insupportable". Si bien que, pour n'emplir ses jours que d'activités passionnantes, il se fit détacher à l'Office et plus tard à la Direction du Travail, "auprès du séduisant Arthur Fontaine", vers qui l'attiraient "des goûts communs de justice sociale, de réforme morale et intellectuelle ". Il y fut chargé d'enquêtes "sur la législation ouvrière encore si rudimentaire en France, sur la limitation des heures de travail des femmes et des enfants et surtout sur cette forme de cynique exploitation du travail à domicile, le sweating system, dont Marx et Engels ont dit dans le Manifeste Communiste que l'ouvrier moderne y descend au-dessous de sa propre classe" (l'Amitié de Charles Péguy).
A ses fonctions Spire donna pendant quatre années le meilleur de son
temps, consacrant presque entièrement les heures qui lui restaient disponibles
à la direction de son Université Populaire : réunions,
recrutement des conférenciers, organisation de visites dans les usines,
préparation de causeries. Mais il était infatigable et trouvait
encore moyen, en marge de l'affaire Dreyfus, de fréquenter, au Quartier
Latin, la Librairie Georges Bellais qu'avait fondée Péguy, la
Société Nouvelle de Librairie et d'Editions, qui avait renfloué
la précédente dont "la finance était épuisée",
les fameux Cahiers de la Quinzaine, la revue Pages Libres
de Charles Guieysse et Maurice Kahn, enfin le Mouvement Socialiste d'Hubert
Lagardelle dont Spire devint le collaborateur.
Voilà donc André Spire, à trente-deux ans, en pleine euphorie
sociale, concentrant sur celle de ses activités qui lui tenait le plus
à cœur, l'Enseignement Mutuel, le meilleur de ses forces, tout le
tumulte bouillonnant de son esprit.
Sa bonne volonté était immense. Rien de ce qu'il voyait, étudiait,
s'assimilait, combattait même, n'était finalement perdu pour une
œuvre qui était devenue sa raison de vivre. Le cadeau qu'il entendait
lui faire, ce "bonheur désintéressé" qu'il apportait
au peuple, n'était ce pas ce qu'il y avait au monde de plus beau ? La
promesse en sonnait déjà comme un cri de victoire. Et pourtant,
cet Avant-Propos de Refuges prend pour évoquer cette
période, ce point culminant d'une activité humanitaire, nous dirions
aujourd'hui humaniste, je ne sais quel ton mélancolique et désabusé.
Un tel élan, tant de joie, une telle certitude pour en venir à
de simples "aspirations", à de pauvres "espoirs",
puis aux "doutes" et aux "échecs" d'une génération
! Cette génération précisément dont Péguy
fut la "conscience", génération d'entre deux guerres,
1870 et 1914, la génération d' André Spire et autres bâtisseurs
d'universités populaires, tour à tour exaltantes et décevantes.
A y regarder de plus près cette mélancolie désabusée n'est pas l'expression toute nue d'une déception. Elle comporte une accusation. C'est le peuple qui "glissa entre les doigts" de ses bienfaiteurs et non pas ses bienfaiteurs qui volontairement le délaissèrent. C'est le peuple qui peu à peu cessa d'assister aux réunions, de suivre les conférences Et cela, pour "retourner", "à ses traditionnelles distractions, aux antiques refuges, la musique et la danse, où, depuis le commencement du monde, il berce sa misère, conserve la bonne humeur et la gaieté". Comment ne pas voir en ces quelques lignes, non dénuées de lucidité, une certaine aigreur et une nuance de mauvaise humeur ? N'affirmait-il pas en effet qu' "avec les salaires trop bas, les trop longues journées de travail auxquels n'avait pas encore été obligée de renoncer la bourgeoisie industrielle", le rêve social de sa jeunesse "était une utopie" ?
André Spire donnait libre cours sa colère. Certes il en voulait aux ouvriers mais il en voulait bien davantage à ses amis, les intellectuels socialistes. Quel temps on lui avait fait perdre ! La mort prématurée de Bazin, survenue le 4 avril, ajouta à son amertume. La grandeur de cette courte vie, que la charité avait consumée et qui s'achevait sur le refus des sacrements, exaltait en Spire le mépris de ceux qu'il avait parés d'une intransigeante noblesse. Combien il préférait il à ce théoriciens le sceptique Daniel Halévy qui, sans affecter la vertu ni promettre au-delà de ce qu'il pouvait tenir, agissait du moins de son mieux. Sans doute subit-il un peu trop l'influence de cet homme riche, qui n'exerçait d'autre profession que celle d'écrivain et dont la lucidité, plutôt que d'embellir le réel, en exagérait la laideur par une sorte d'idéalisme à rebours.
Mais si Halévy entretint, probablement sans le savoir, le désespoir d'André Spire, comment lui contester le mérite d'avoir détourné son ami de préoccupations trop exclusivement sociales pour le ramener peu à peu aux lettres, à la poésie? En dépit du surmenage qu'il s'imposait, Spire avait toujours beaucoup lu. Ses lectures se firent moins sévères. Il rouvrit ses livres tentateurs, en découvrit de nouveaux.
Jamais non plus il n'avait tout à fait cessé d'écrire, de prendre des notes, de saisir au vol des idées de poèmes. Il réveilla ses manuscrits anciens, se surprit à les classer, rejeta, corrigea, choisit. Tout se passa comme si un interdit prononcé contre la poésie une dizaine d'années plus tôt, était soudain levé.
Le volume (La cité présente) fut prêt à la fin de 1902. Quelques mois plus tôt, Spire, saturé de bureaucratie et plus encore de statistique, avait quitté le ministère du Travail pour devenir chef adjoint du cabinet de Jean Dupuy, ministre de l'Agriculture dans le ministère de Waldeck-Rousseau. Ses fonctions l'amenaient à fréquenter les milieux parlementaires, nouveaux pour lui.
Depuis plus de deux ans, Spire connaissant personnellement Charles Péguy. Il allait le voir chez lui à Orsay, ou dans la célèbre boutique du 8 rue de la Sorbonne. Non seulement il admirait son génie, mais il aimait sa combativité et, à travers son socialisme, son individualisme anarchiste. Il raconte, dans le numéro de l'Amitié Charles Péguy, qu'il retrouva chez l'homme, dès qu'il le rencontra, ce besoin "de vérité totale, d'indépendance sans contrôle" qui l'avait tout de suite subjugué "dans le Péguy des premiers Cahiers". C'est ce Péguy qu'il devait soutenir obstinément.
Les raisons de s'entendre ne manquaient pas à Spire et à Péguy. Les deux hommes savaient mettre parfois leurs soucis d'action en sommeil, le temps d'une soirée, pour s'entretenir de poésie. Péguy aimait que Spire, dans son nouvel appartement de la rue de Beaune, lui chantât de vieilles chansons populaires françaises. Un soir, entraîné par la discussion, Spire montra à Péguy quelques-uns des poèmes, datant de ses dernières années de lycée ou plus récents, qui composaient le recueil en projet. Péguy "poliment" le pria de lui confier son manuscrit et l'emporta. Lorsqu'il le lui renvoya en l'informant qu'il ne le retenait pas pour la série des Cahiers, le poète n'en fut "ni surpris ni mortifié". La plupart de ces poèmes, il l'ignorait moins que personne, "reflétaient les diverses influences romantiques, parnassiennes, symbolistes, subies par un débutant qui cherchait, mais était loin d'avoir trouvé sa personnalité".
C'est chez Ollendorff, où Spire avait un ami, Georges Delahache, que parut, en janvier 1903, à compte d'auteur, sa Cité présente, dont il déclara par la suite que le titre seul mérite d'être conservé".
C'est sans doute aller un peu loin ! Car s'il y a dans ce volume des vers badins et galants, des matériaux puérils, des banalités, des facilités, on y trouve aussi en germe l'amour de la justice, le culte de l'humain, less indignations, la pitié qui, pour s'y exprimer avec une gaucherie emphatique, n 'en préfigurent pas moins par l'inspiration le véritable André Spire. Une évolution s'y dessine, en dépit de l'ordre non chronologique des poèmes : elle va de 1835 à 1902, c'est-à-dire de la dix-huitième à la trente-cinquième année de l'auteur. Les influences ? Musset, Vigny, Sully Prudhomme, Verlaine sont certes des noms auxquels on est en droit de penser. Par contre, bien que diffuse et anonyme, l'influence du symbolisme saute aux yeux dans les tentatives de libération du vers. Il y a cependant du vrai dans la boutade d'André Spire : son titre contient tout le livre. Le poète, obsédé par la cité future, qu'il appelle sur un mode biblique la "cité promise", ne s'intéresse plus à rien en dehors d'elle. Qu'elle s'évanouisse à l'horizon, et la "cité présente" lui réapparaît. Il retrouve la vie et la beauté, la réalité quotidienne, l'amour, les livres, la musique : tout ce qu'il a essayé de chanter dans sa prime jeunesse.
André Spire ne pouvait s'attendre à ce que son livre fit du bruit. Il fut content, bien entendu, de l'aimable note que glissa dans Fémina, le 1er mars 1903, son collègue auprès de Jean Dupuy, le jeune poète des Pleureuses, Henri Barbusse. Mais le petit nombre des comptes rendus ne le troubla pas. Ce qui importait, c'était que l'impulsion fût donnée, et elle l'était. "Je faisais toujours des vers, écrira-t-il dans l'Amitié Péguy, et me passionnais de plus en plus pour la composition poétique." Entre-temps, Waldeck-Rousseau renversé, André Spire, rompant ses amarres, quittait définitivement le Conseil d'Etat, rentrait quelques mois au ministère du Travail, passait par permutation au ministère de l'Agriculture, où il était affecté au service du Crédit et de la Mutualité Agricoles. Inspecteur, puis Inspecteur général jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite en 1926, ses fonctions, en dehors de trois ou quatre mois de tournée d'inspection en province, lui laissaient des loisirs. Ce fut alors, selon son propre témoignage, la phase de sa vie la plus favorable à son activité de poète.
Il lui fallut à peine deux ans pour mettre au point un recueil nouveau et commencer vraiment son œuvre. Il se "hasarda" en 1905 à consulter Péguy. Certes sa "manière d'écrire" avait changé. Etait-ce là "simple progrès" ou "mutation" ? Qu'importe! Ecoutons la suite du récit :
"Toujours est-il que lorsque Péguy eut les poèmes entre les mains, en eut entrebâillé la liasse, oh ! ce ne fut pas long, pas cinq minutes, il tomba en arrêt sur une page. Ses lèvres remuèrent, murmurèrent :
Ma barque lentement descend le fil de l'eau.
Les arbres sont penchés sur la rivière calme.
Un poisson saute en l'air en faisant un bruit plat.
- Je prends, dit-il."
Et en décembre les Cahiers de la Quinzaine consacraient le huitième cahier de leur septième série, ou "cahier pour le jour de l'an", à la publication de Et vous riez !
Les thèmes sont ceux du précédent livre, à cette
différence près qu'ils ont recouvré l'authenticité.
Désencombrés du convenu, du "poétique", ils nourrissent
de leur âpreté un réalisme qui est poésie. Certes
la "manière d'écrire" a changé, mais d'abord
la manière de sentir, dont l'écriture n'est qu'un ricochet. Blessé
par la cruauté de la vie, Spire enchérit sur cette cruauté
: son humour est une riposte.
Quant à l'éloquence, il est trop ému pour ne pas lui tordre
"son cou". Au lieu de développer pour expliquer, il trouve
le mot-choc, qui restitue la sensation avec toutes ses harmoniques. Adieu donc
l'adjectif inutile ! Vive le "bruit plat", qui fit sursauter Péguy
et emporta l'édition ! Le point de départ est la colère.
La colère contre le peuple. Ravalée, elle vire au mépris
:
| Le peuple grouille dans la rue Et n'est pas là pour s'indigner. Les garçons agacent les filles, Les phonographes nasillent, Et vous riez ! Et vous riez ! |
Ou à la pitié, ce qui est pire :
|
Nous irons nous grouper, parfois, sur ton passage, Et tristement pleurer sur ton destin tragique, O fleuve infortuné de germes avortés. |
A moins qu'une "chanson de servante" ne la débarrasse du sarcasme :
|
Va, mon torchon, mon pauvre ami, Nous n'en aurons jamais fini. |
| Page précédente | Page suivante |
 |